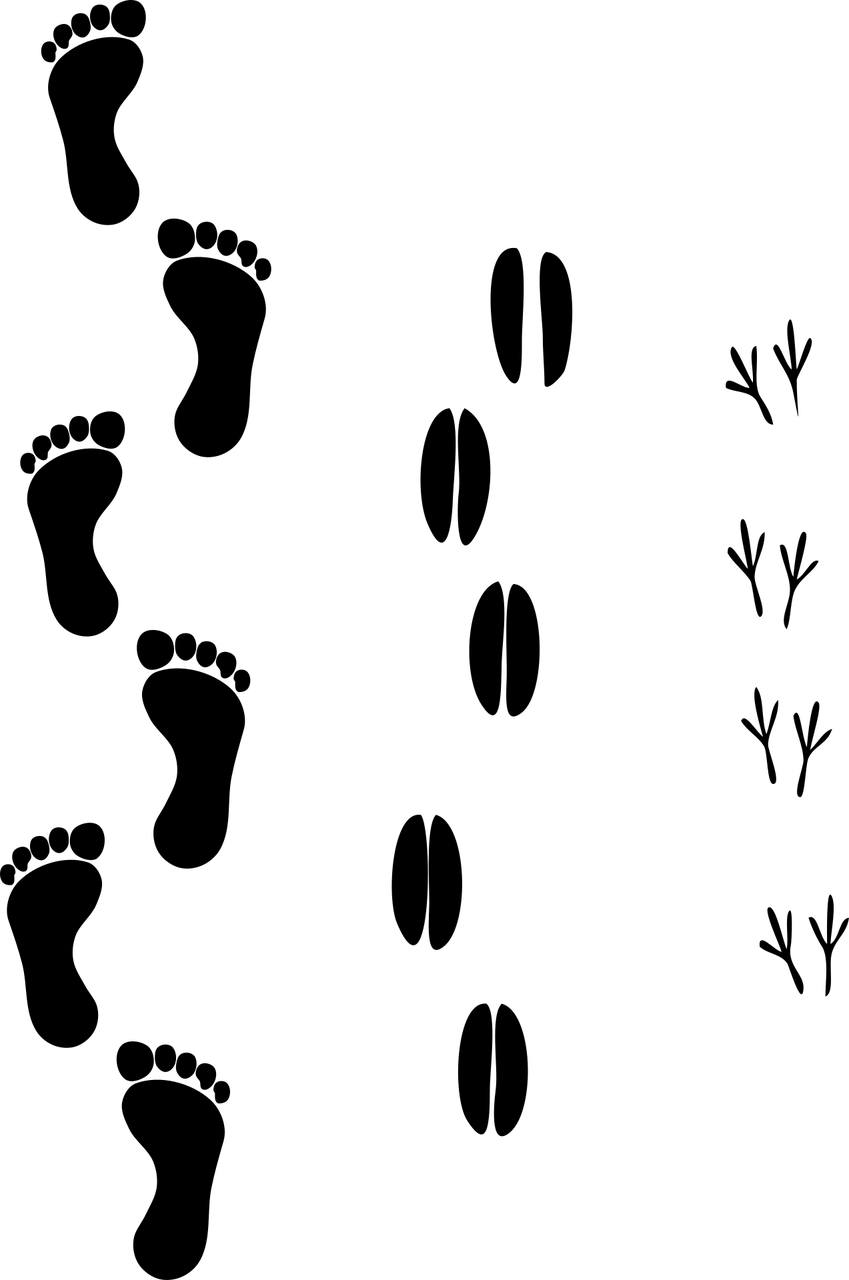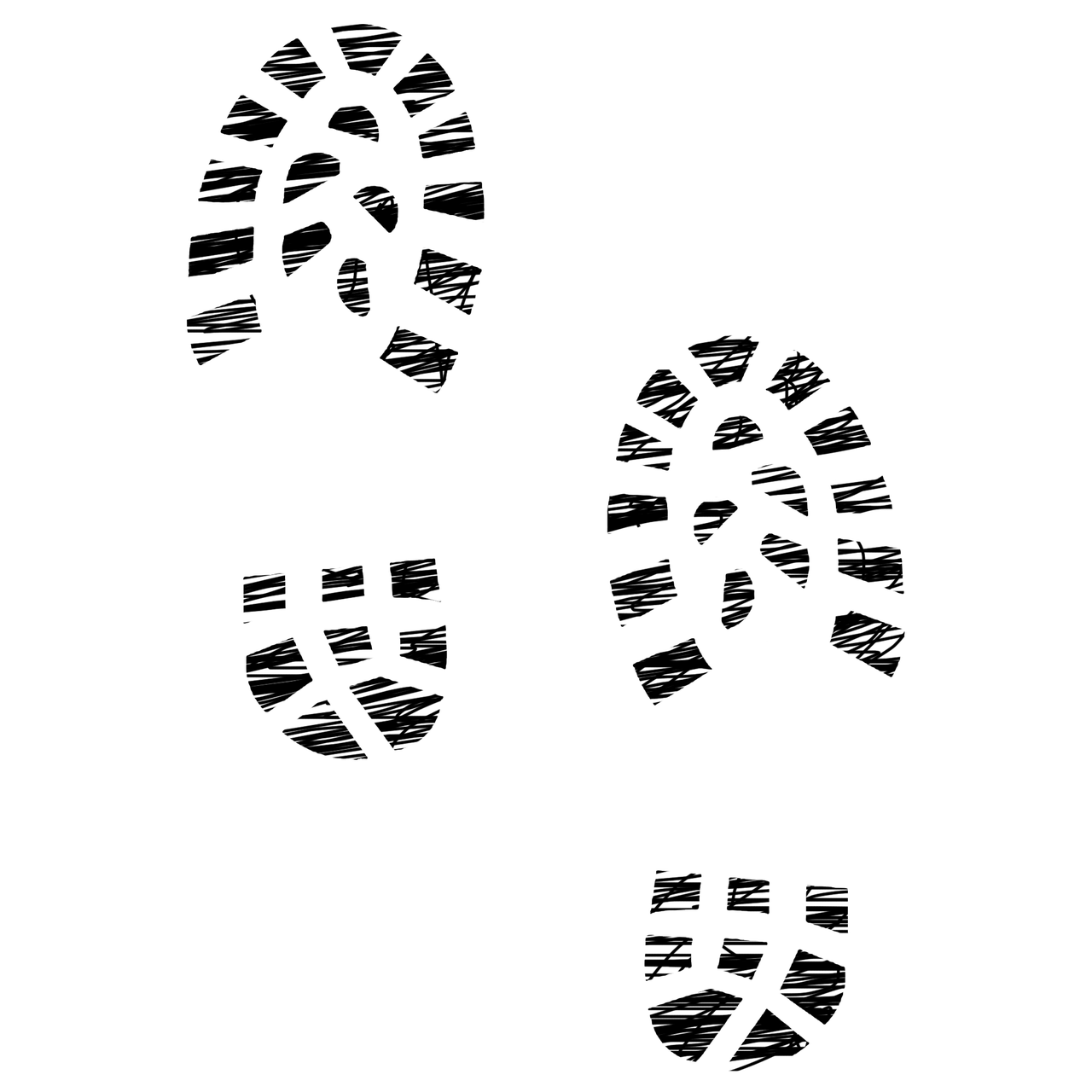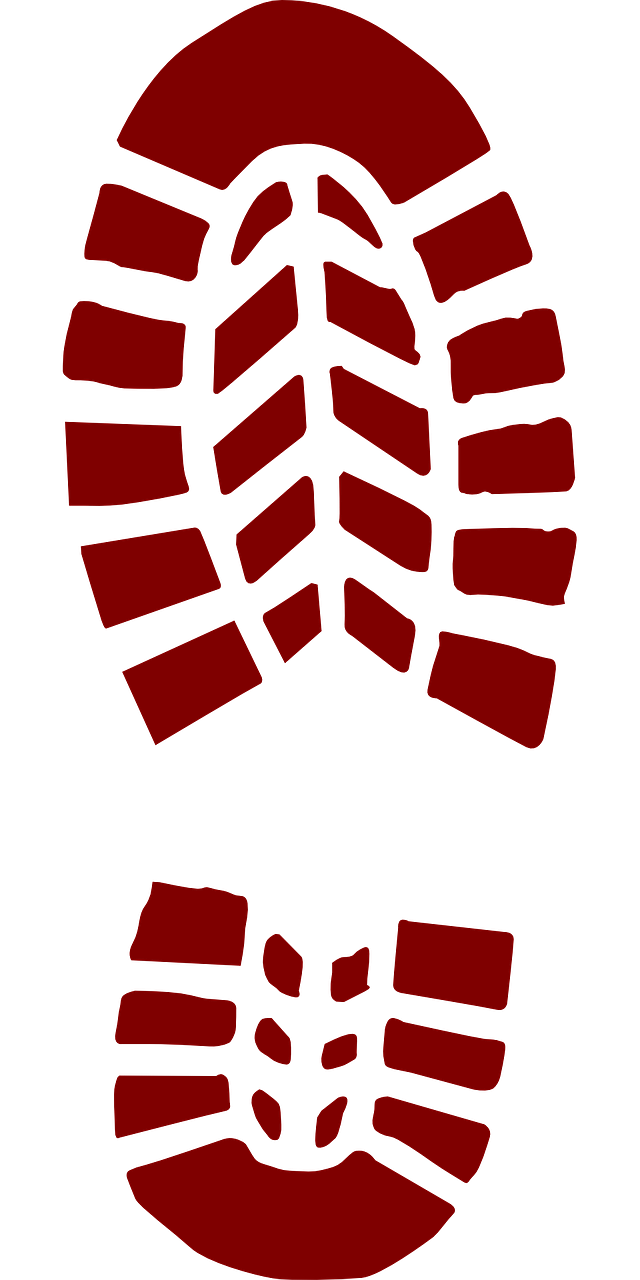|
EN BREF
|
En 2022, La Rochelle Université a entrepris une évaluation de son bilan de gaz à effet de serre, englobant l’intégralité de ses activités. Ce bilan révèle que, sur l’année 2019, l’établissement a émis près de 11 902 tonnes de CO2e, soit environ 1,23 tonne de CO2e par usager. Les principaux postes d’émissions identifiés incluent les déplacements (45%) et les achats (18%). Pour concrétiser son engagement envers un avenir durable, l’université a adopté un plan d’action visant à réduire son empreinte carbone, comprenant des formations à la transition écologique, la réduction des déplacements professionnels, et une attention particulière à la mobilité durable et à la sobriété dans les achats publics. Un suivi régulier des progrès sera réalisé, avec un nouveau bilan prévu pour 2024.
À une époque où la préoccupante question du changement climatique occupe une place prépondérante dans les débats internationaux, les établissements d’enseignement supérieur sont appelés à prendre conscience de leur responsabilité environnementale. Cet article explore l’importance d’évaluer l’empreinte carbone des universités, en mettant en lumière le bilan de gaz à effet de serre (GES) des institutions académiques ainsi que les actions mises en oeuvre pour réduire cet impact. En examinant le cas de La Rochelle Université comme exemple, nous fournirons des aperçus sur l’état actuel de la durabilité dans l’enseignement supérieur et des recommandations pour un avenir plus respectueux de l’environnement.
Comprendre le concept d’empreinte carbone
L’empreinte carbone d’une organisation est définie comme la somme des gaz à effet de serre (GES) émis directement et indirectement par ses activités. Cette évaluation est primordiale pour identifier les principales sources d’émission et déterminer les stratégies nécessaires pour les réduire. Le bilan carbone, ou bilan GES, inclut généralement trois scopes : le scope 1 qui couvre les émissions directes (ex. combustibles fossiles utilisés pour le chauffage), le scope 2 qui concerne les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, et le scope 3 qui englobe toutes les autres émissions indirectes, y compris celles générées par les déplacements, les achats de biens et services ainsi que la gestion des déchets.
L’importance d’une évaluation précise
Mesurer l’empreinte carbone permet aux universités de prendre conscience de leur impact environnemental et de déclencher des actions ciblées. Les résultats d’un bilan carbone fournissent non seulement des indicateurs clairs de performance, mais ils renforcent également la transparence et la responsabilité auprès des étudiants, du personnel et de la communauté environnante. En prenant conscience de leurs contributions aux émissions de GES, les universités peuvent transformer leur modèle d’opération pour devenir des leaders dans le domaine de la durabilité.
Le bilan carbone de La Rochelle Université
En 2022, La Rochelle Université a réalisé son bilan carbone, qui a inclus l’intégralité de son périmètre d’activité, englobant les scopes 1, 2 et 3. Les résultats obtenus ont révélé que les émissions globales de l’Université se chiffraient à 11 902 tonnes de CO2 équivalent (CO2e) pour l’année 2019. Cette donnée souligne le niveau critique d’impact écologique que peut avoir une institution académique, mais elle représente également une opportunité pour la communauté universitaire de s’engager dans une démarche d’amélioration.
Les sources d’émissions
Les résultats de l’analyse révèlent que les déplacements, notamment ceux entre le domicile et le campus, constituent la part la plus significative des émissions de l’université, représentant près de 45% des émissions totales. Les autres sources notables incluent les achats (18 %), l’énergie utilisée dans les bâtiments (14 %), les immobilisations matérielles (22 %) et les déchets directs qui contribuent à hauteur de 1 %. Ces résultats illustrent la nécessité d’adopter une stratégie multidimensionnelle pour réduire les émissions des différents postes.
Élaborer un plan d’action viable
Suite à la publication de son bilan carbone, La Rochelle Université a voté un plan d’action ambitieux lors de son conseil d’administration en septembre 2022. Ce plan a pour objectif de réduire les émissions de GES à travers plusieurs actions spécifiques organisées sur le court, moyen et long terme. Un aspect fondamental de ce plan est l’implication de tous les acteurs de l’université, notamment en matière de sensibilisation et de formation.
Mobilisation et sensibilisation
Pour intégrer l’ensemble de la communauté dans ce défi environnemental, des initiatives de sensibilisation sont mises en œuvre. Par exemple, une première formation a été dispensée à la Fresque du climat pour l’équipe présidentielle et les responsables des services. Ce type de formation est crucial pour assurer une appropriation collective des enjeux liés à l’énergie et au climat. Par ailleurs, un module de formation sur la transition écologique à destination des étudiants est également en projet. Cela vise à sensibiliser la prochaine génération à l’importance de la durabilité et de la responsabilité environnementale.
Mesures concrètes pour réduire les émissions
Dans le cadre de ce plan d’action détaillé, diverses mesures ont été décidées. Parmi elles, on note la réduction des déplacements professionnels et l’incitation à recourir à l’usage du train comme moyen de transport privilégié. La mise en œuvre d’une politique de mobilité durable est essentielle pour diminuer les émissions liées aux déplacements.
Priorité à des achats responsables
Une autre mesure stratégique concerne la sobriété dans les achats publics. Une attention particulière sera portée sur les produits numériques responsables ainsi que sur les marchés à fort impact carbone. En favorisant des matériaux écoresponsables et des prestataires engagés, l’université peut nettement réduire son empreinte carbone tout en soutenant l’économie circulaire.
Le suivi des actions et des résultats
Pour garantir le succès de ces initiatives, un suivi régulier des actions sera mis en place par l’intermédiaire de comités de pilotage dédiés à la démarche de Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DDRS). Ce suivi est essentiel pour ajuster les stratégies et s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés.
Préparation pour le futur
Un nouveau bilan carbone est prévu pour l’année 2024, visant à actualiser les données, mesurer les évolutions et orienter de manière adéquate les actions futures. En continuant d’évaluer et d’analyser son empreinte carbone, La Rochelle Université démontre son engagement en matière de durabilité et son intention de servir d’exemple par une gestion responsable des ressources.
Les défis à relever pour les institutions académiques
Bien que des progrès aient été réalisés, les universités doivent relever de multiples défis. Premièrement, la sensibilisation des différents acteurs aux enjeux environnementaux demeure un obstacle majeur. De plus, l’intégration de la durabilité dans les pratiques académiques et administratives requiert un changement culturel qui peut se heurter à des habitudes bien ancrées.
Les attentes croissantes des parties prenantes
Les étudiants, le personnel universitaire et la société en général attendent davantage des universités en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette pression croissante pousse les établissements à évoluer nécessitant ainsi des stratégies claires et mesurables pour répondre aux attentes des parties prenantes. Des plateformes comme univ-lille.fr offrent des services utiles pour aider à évaluer et réduire les impacts des activités de recherche, témoignant de la volonté d’agir pour un avenir meilleur.
Rôle et enjeux de la recherche dans l’évaluation de l’empreinte carbone
Il est également crucial d’explorer comment la recherche elle-même, souvent responsable d’une part importante des émissions, peut contribuer à l’évaluation et à la réduction de l’empreinte carbone. En effet, le secteur académique est au cœur des innovations qui permettent de créer des solutions durables. Les projets de recherche peuvent aider à mieux comprendre l’impact environnemental de certaines pratiques académiques, notamment à travers l’étude des déplacements, de l’organisation d’événements et du numérique.
Partenariats et collaborations
Les universités peuvent renforcer leur impact en établissant des collaborations avec le secteur entrepreneurial et les organisations non gouvernementales. De tels partenariats sont bénéfiques pour échanger des bonnes pratiques et développer des projets innovants qui visent à réduire l’empreinte carbone à l’échelle régionale et nationale. La collaboration entre universités et entreprises, notamment pour le développement de technologies vertes, est un axe prometteur à explorer pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions.
Conclusion sur l’impact environnemental des universités
En fin de compte, évaluer l’empreinte carbone des universités est une démarche essentielle qui a des implications profondes sur l’ensemble de la société. Les établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle clé dans la formation des futurs leaders et professionnels qui seront responsables de gérer nos ressources naturelles de manière durable. En prenant les devants dans l’évaluation de leur impact environnemental, les universités peuvent montrer l’exemple et encourager un changement positif à travers des actions mesurées et concrètes. Ce cheminement vers la durabilité nécessite une implication collective et un engagement sans faille de toutes les parties prenantes de l’université.

Témoignages sur l’évaluation de l’empreinte carbone de l’Université
« L’évaluation de l’empreinte carbone de notre Université a été une étape cruciale pour comprendre l’impact environnemental de nos activités. Les résultats du bilan de gaz à effet de serre ont immédiatement révélé les domaines où nous pouvions agir. C’est une véritable prise de conscience collective qui a suscité une dynamique au sein de notre campus. »
« En participant à la formation sur la transition écologique, j’ai réalisé à quel point chaque geste compte. La réduction des déplacements et l’adoption de modes de transport plus durables doivent devenir une norme. Les efforts de sensibilisation sont essentiels pour impliquer l’ensemble de la communauté universitaire. »
« Je suis impressionné par l’engagement de l’Université à avancer vers un avenir plus durable. La mise en place d’un plan d’action concret après l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre est une démarche exemplaire. Chaque laboratoire réfléchit activement à son propre bilan carbone, promouvant ainsi des changements à l’échelle individuelle et collective. »
« Le constat des émissions globales de l’Université, qui s’élèvent à près de 12 000 tonnes de CO2 équivalent, a été un choc. Cette révélation nous oblige à reconsidérer nos pratiques au quotidien. Chaque composante de l’Université doit maintenant se sentir responsable du changement à opérer. »
« Participer à la Fresque du climat a été une expérience révélatrice. Cela nous a permis de mieux saisir les enjeux énergétiques et climatiques. J’espère que ces initiatives inciteront davantage d’étudiants à prendre en main leur rôle dans la préservation de notre environnement. »
« L’université a toujours été un lieu d’apprentissage. Évaluer et réduire notre empreinte carbonne en fait désormais partie intégrante de notre mission éducative. Cette évolution montre que l’éducation ne se limite pas à l’académique, mais englobe également notre responsabilité envers la planète. »