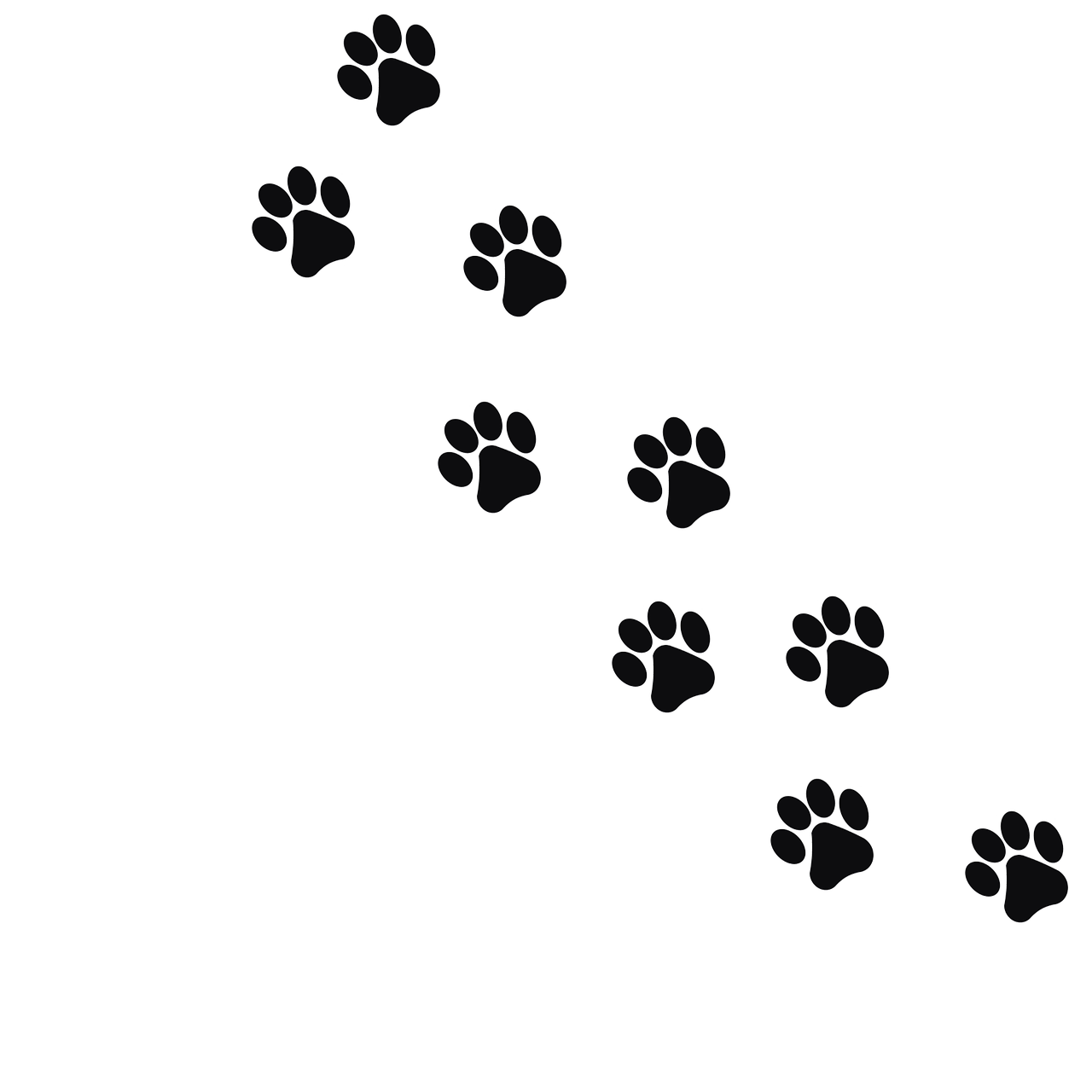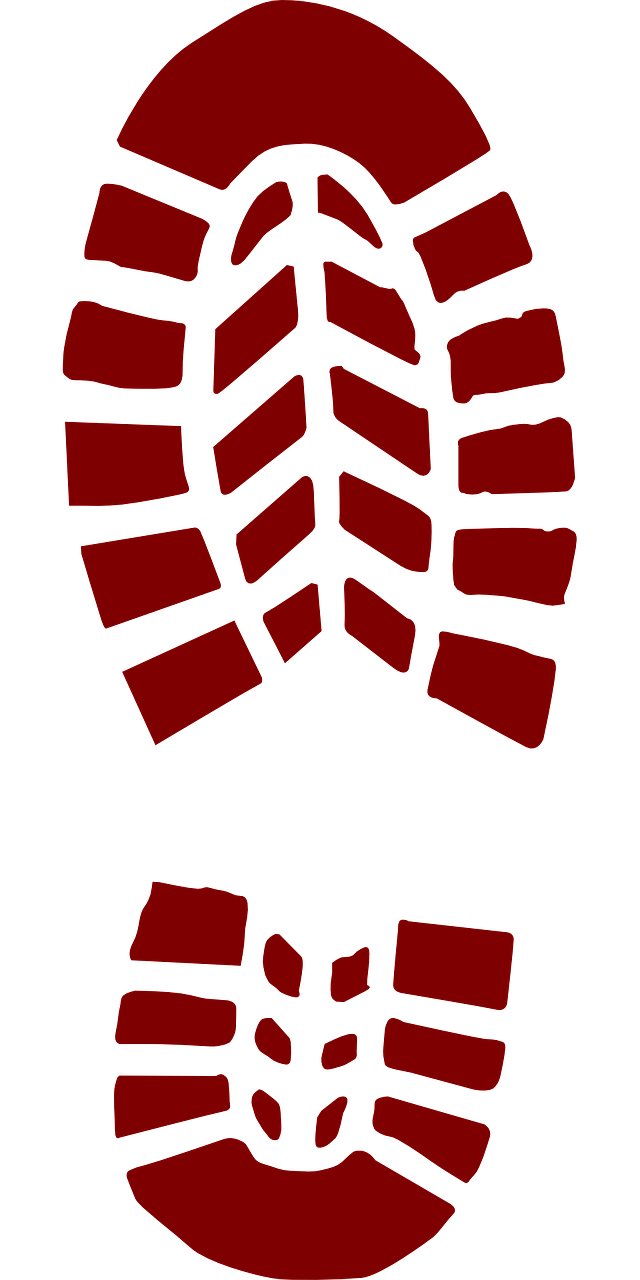|
EN BREF
|
Le secteur de l’élevage est un contributeur majeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), représentant environ 14% des totales, dont près de 60% proviennent des activités d’élevage. Les principaux gaz incriminés sont le méthane (CH4), émis par la digestion des ruminants, et le protoxyde d’azote (N2O), lié à l’utilisation d’engrais. En France, le méthane constitue 45% des émissions de GES du secteur agricole. Les stratégies de réduction incluent l’amélioration génétique des animaux, l’optimisation de leur alimentation et le développement de systèmes d’élevage extensifs. La prise en compte des services environnementaux fournis par les prairies et la gestion des effluents est essentielle dans la démarche de neutralité carbone visée d’ici 2050. L’élevage, en plus d’émettre des GES, joue un rôle crucial dans les cycles biogéochimiques et la préservation de la biodiversité, rendant nécessaire une réévaluation de ses pratiques pour une durabilité accrue.
L’industrie de l’élevage joue un rôle majeur dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), représentant environ 14 % des émissions liées à l’agriculture, dont 60 % proviennent directement de l’élevage. Cet article explore les différentes dimensions de l’empreinte carbone de l’élevage, les GES impliqués, les stratégies de réduction mises en place en France et en Europe, et l’importance des pratiques durables pour un avenir écologique.
Les principaux gaz à effet de serre liés à l’élevage
L’élevage est responsable d’émissions significatives de trois principaux GES : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et le dioxide de carbone (CO2). Le méthane, émanant principalement de la digestion des ruminants ainsi que des effluents, a un pouvoir de réchauffement global 28 fois plus élevé que celui du CO2, bien qu’il ait une durée de vie dans l’atmosphère bien plus courte, soit environ 10 ans contre 100 ans pour le dioxyde de carbone.
Le protoxyde d’azote résulte principalement de l’utilisation d’engrais pour la production de l’alimentation animale, tandis que le dioxyde de carbone provient des divers processus tels que les transports, le chauffage des bâtiments ou l’utilisation de machines. L’alimentation des animaux représente une part considérable des émissions, allant jusqu’à 85 % dans le cas des volailles et des porcs, tandis que les ruminants, qui consomment également de l’herbe, affichent des participations relativement plus faibles dans ce domaine.
Impact global de l’élevage sur le changement climatique
À l’échelle mondiale, l’industrie de l’élevage contribue à 16 % des émissions de méthane, un gaz qui, bien qu’émettant moins de CO2, a des implications sérieuses pour le réchauffement climatique. Bien que l’Europe ait enregistré une diminution de 39 % des émissions de méthane entre 1990 et 2020, la concentration de ce gaz dans l’atmosphère continue de croître à l’échelle planétaire, suivant la trajectoire pessimiste des experts du GIEC.
Les services environnementaux fournis par l’élevage
Malgré son empreinte carbone, il est crucial de reconnaître les services environnementaux que l’élevage peut fournir, comme le stockage de carbone dans les prairies et la valorisation des produits végétaux non consommables par l’homme. Les prairies, essentielles à la biodiversité, peuvent stocker jusqu’à 85 tonnes de carbone par hectare, enrichies par les déjections animales.
Ces espaces naturels jouent un rôle vital dans le cycle de la nourriture et des nutriments, capable de fertiliser les cultures grâce aux excrétions des animaux. La reconnection des cycles biogéochimiques dans l’agriculture est une voie prometteuse pour une pratique plus durable.
Les initiatives en France et en Europe pour une réduction des émissions
La France et l’Union européenne ont engagé des plans ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Dans ce cadre, la troisième Stratégie nationale bas-carbone inclut des mesures pour réduire les émissions et maintenir les stocks de carbone dans les sols, en préservant notamment les prairies permanentes.
Dans le cadre français, le programme METHANE 2030 vise une réduction de 30 % des émissions de méthane des filières bovines en dix ans, en se concentrant sur l’optimisation des pratiques d’élevage, la génétique et la nutrition.
La génétique et l’alimentation comme leviers de réduction des émissions
La sélection génétique des animaux et l’adaptation de l’alimentation sont des leviers clé pour réduire l’empreinte carbone de l’élevage. Des pratiques comme l’amélioration génétique, des régimes alimentaires adaptés et le croisement entre espèces permettent de maximiser la production animale tout en minimisant les émissions de GES. La recherche continue d’explorer des solutions basées sur la science pour atteindre ces objectifs de durabilité.
Optimiser la productivité tout en préservant l’environnement
Pour améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage, les efforts portent sur l’allongement des périodes productives des animaux, facilitant ainsi la transition vers des pratiques plus durables. Cette approche inclut l’analyse des cycles de vie pour mieux évaluer l’impact de l’alimentation sur le bilan carbone des exploitations, et l’utilisation d’aliments à faible empreinte carbone.
Les prairies comme atout pour le stockage de carbone et la biodiversité
Les prairies permanentes, qui sont vitales pour le stockage du carbone et la conservation de la biodiversité, doivent être protégées contre la spécialisation excessive des régions d’élevage. La restauration de ces écosystèmes nécessite une gestion appropriée afin de maintenir leur fonction écologique tout en soutenant les pratiques agricoles.
Les défis de l’élevage durable dans un contexte de changement climatique
Les défis liés à l’élevage durable et au changement climatique nécessitent une approche intégrée, comprenant des solutions innovantes et des politiques publiques favorables. La création de métriques pour quantifier les services environnementaux associés à l’élevage est cruciale pour inciter à des pratiques agricoles responsables et pour stimuler les recherches sur le sujet.
Le rôle de l’éducation et de la sensibilisation
Enfin, il est essentiel de sensibiliser le public et les éleveurs aux enjeux liés à l’empreinte carbone de l’élevage. Des programmes d’éducation visant à promouvoir des pratiques durables et des modes de consommation responsables peuvent également jouer un rôle prépondérant dans la réduction des émissions.

Témoignages sur l’empreinte carbone de l’industrie de l’élevage
Dans le cadre des discussions autour de l’empreinte carbone de l’industrie de l’élevage, de nombreux acteurs du secteur partagent leurs préoccupations et leur engagement. Un agriculteur, après avoir pris conscience de l’impact de ses pratiques sur l’environnement, a déclaré : « J’ai décidé de modifier mes méthodes d’élevage. L’utilisation d’aliments à faible bilan carbone a permis de réduire mes émissions de méthane et d’améliorer la durabilité de mon exploitation. »
Un vétérinaire spécialisé a également exprimé son point de vue : « Chaque jour, je vois comment les méthodes d’élevage peuvent affecter l’écologie. En améliorant la nutrition et les standards de santé des animaux, nous pouvons avoir un impact direct sur la réduction des GES. »
Une représentante d’une ONG environnementale a partagé ses inquiétudes : « L’élevage représente une part significative des émissions de gaz à effet de serre. Il est crucial d’accroître la sensibilisation et d’encourager des pratiques plus durables pour protéger notre planète. »
Une étudiante en agronomie a évoqué son expérience d’apprentissage sur le terrain : « J’ai assisté à plusieurs projets sur la réduction de l’empreinte carbone dans l’élevage. Les résultats sont prometteurs, mais il faut un engagement collectif pour aller plus loin. »
Pour conclure, un éleveur innovant a ajouté : « En intégrant des pratiques comme la sélection génétique avancée et la gestion des effluents, nous pouvons non seulement limiter notre impact environnemental, mais aussi améliorer la rentabilité de nos exploitations. »